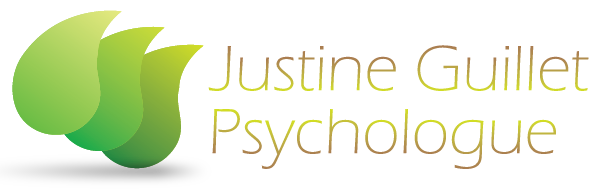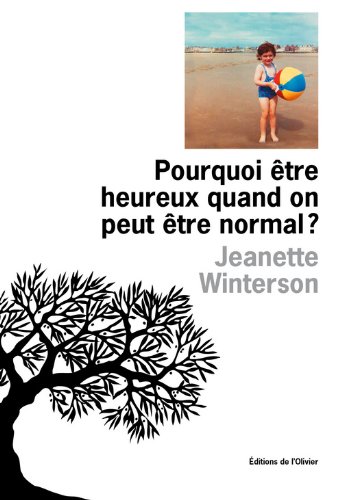Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?
Étrange question, à laquelle Jeanette Winterson répond en menant une existence en forme de combat. Dès l’enfance, il faut lutter : contre une mère adoptive sévère, qui s’aime peu et ne sait pas aimer. Contre les diktats religieux ou sociaux. Et pour trouver sa voie.
Ce livre est une autobiographie guidée par la fantaisie et la férocité, mais c’est surtout l’histoire d’une quête, celle du bonheur. «La vie est faite de couches, elle est fluide, mouvante, fragmentaire», dit Jeanette Winterson. Pour cette petite fille surdouée issue du prolétariat de Manchester, l’écriture est d’abord ce qui sauve. En racontant son histoire, Jeanette Winterson adresse un signe fraternel à toutes celles – et à tous ceux – pour qui la liberté est à conquérir.
Née en Angleterre en 1959, Jeanette Winterson a connu le succès dès la parution de son premier roman, Les oranges ne sont pas les seuls fruits (réédité aux Éditions de l’Olivier en 2012). Couronnée de prix, elle devient une figure du mouvement féministe. Ses romans baroques, ses essais, notamment sur l’identité sexuelle (Le Sexe des cerises ou Powerbook), ont imposé sa voix singulière dans la littérature britannique.
La revue de presse
- Augustin Trapenard – Le Magazine Littéraire, juin 2012
«Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» C’est la phrase que sa mère adoptive lui rétorque du tac au tac le jour où Jeanette Winterson tente bon gré mal gré de lui justifier son homosexualité. Avec un mélange de tendresse et d’amertume, la romancière anglaise revient sur ce qui semble d’abord être un chemin de croix : son apprentissage de la liberté, du savoir et de l’amour, «qui se mesure, dit-elle, à l’étendue de la perte»…
Loin du récit d’une enfance volée, c’est celui d’une libération que dessine l’auteur de 52 ans, considérée comme une icône du féminisme anglo-saxon. Libération du corps comme des carcans de la société, depuis son expérience de la marge jusqu’à la prise en main de son propre destin : s’assumer seule, assouvir sa soif de savoir, et devenir écrivain. Une libération dont la littérature (ou plutôt le langage littéraire) est à la fois le moteur et le point d’orgue.
- Josyane Savigneau – Le Monde du 14 juin 2012
Si elle sait aimer, elle ne sait pas se laisser aimer. Pour apprendre, elle doit sans doute refaire le chemin, chercher sa mère biologique pour savoir si elle n’a été qu’une enfant non voulue ou si, désirée, elle a été abandonnée parce qu’on espérait pour elle une vie meilleure. C’est un long voyage, qu’il faut faire avec elle dans ce livre bouleversant.
- Michel Schneider – Le Point du 7 juin 2012
Figure du mouvement féministe, couronnée de multiples prix, Jeanette Winterson a connu, via Oxford, une carrière littéraire admirable, rarement accessible aux femmes de sa classe sociale. Mais il y a un manque premier, radical, incomblable : le manque d’amour. L’essentiel du livre raconte cette quête…
Au terme de cette quête parmi le malheur normal, les surprises de l’amour feront resurgir Ann, la vraie mère. « Ce qui se dresse devant moi, pareil à un étranger qu’il me semble reconnaître, est l’amour. » Happy ending tout en pudeur et d’une poignante concision, cette mère retrouvée lui écrit ce que nous aimerions tous avoir entendu de la nôtre, vraie ou fausse : « Tu as toujours été désirée. »
- Nathalie Crom – Télérama du 25 avril 2012
L’auteur anglaise décrit une enfance soumise à la tyrannie d’une mère morbide…
Dickens n’aurait sans doute pas renié un tel personnage. Une femme immense et sonore. Une femme «pas à la bonne échelle, plus vaste que nature», rappelant «les contes de fées où les proportions sont approximatives et instables». Il s’agit de Mrs Winterson, la mère de l’auteur. Cent vingt kilos d’autorité fantasque et brutale…
Pourtant, davantage qu’une enfance malheureuse, c’est une émancipation que raconte Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? C’est là toute la beauté saisissante de ces Mémoires graves, mais tout sauf apitoyés, que de s’offrir à lire comme un grand récit profondément vivant, un bréviaire pour la liberté de penser et d’aimer. Un itinéraire intellectuel, spirituel et affectif, dans lequel la souffrance infligée, les humiliations et les brimades ne sont ni minorées ni sottement exaltées. Elles ont un poids – «autrefois, j’abritais une colère si énorme qu’elle aurait pu remplir n’importe quelle maison» -, elles génèrent le chagrin et le doute, elles firent trébucher Jeanette Winterson plus d’une fois, mais jamais elles ne parvinrent à entraver l’élan vers une vie meilleure, une vie nouvelle…
C’est cette réflexion protéiforme sur l’enfance, sur les origines, sur l’amour et le temps, qui, au-delà de l’énoncé des faits biographiques, donne au récit son épaisseur, sa belle et universelle valeur. Un prix qui a trait à la sincérité, au pardon, à la confiance. Osons le mot : à la foi en une possible rédemption.
- Ali Smith, The Scotsman
Les livres de Jeanette Winterson, apatrides et sans visage, brillent des multiples reflets de la grande Albion : la majesté de Shakespeare, l’absolutisme de Lawrence, le calme de Woolf ou la farce de Chaucer. C’est une magicienne.
Les premières lignes
Quand ma mère se fâchait contre moi, ce qui lui arrivait souvent, elle disait : «Le Diable nous a dirigés vers le mauvais berceau.»
L’image de Satan prenant congé de la guerre froide et du maccarthysme le temps de faire un crochet par Manchester en 1960 – but de la visite : duper Mrs Winterson – est théâtralement truculente. Ma mère elle-même était une dépressive truculente ; une femme qui cachait un revolver dans le tiroir à chiffons et les balles dans une boîte de produit nettoyant Pledge. Une femme qui passait ses nuits à faire des gâteaux pour ne pas avoir à dormir dans le même lit que mon père. Une femme qui avait une descente d’organes, une thyroïde déficiente, un coeur hypertrophié, une jambe ulcéreuse jamais guérie, et deux dentiers – un mat pour tous les jours et un perlé pour les «grands jours».
J’ignore pourquoi elle n’avait/ne pouvait pas avoir d’enfant. Je sais qu’elle m’a adoptée parce qu’elle voulait une amie (elle n’en avait aucune), et parce que j’étais comme une fusée éclairante lancée à l’adresse du monde – une façon de dire qu’elle était là -, une sorte de croix marquant sa présence sur la carte.
Elle détestait son anonymat, et comme tous les enfants, adoptés ou non, j’ai dû vivre une partie de ce qu’elle avait rêvé pour sa propre existence. Nous faisons ce genre de choses pour nos parents – ils ne nous laissent pas vraiment le choix.
Elle était encore en vie quand mon premier roman, Les oranges ne sont pas les seuls fruits, a été publié en 1985. Il est en partie autobiographique dans le sens où il raconte l’histoire d’une petite fille adoptée par un couple de pentecôtistes. On la destine à être missionnaire. Au lieu de cela, elle tombe amoureuse d’une fille. Catastrophe. La jeune fille quitte la maison, se débrouille pour entrer à Oxford, puis revient chez elle où elle découvre que sa mère s’est bricolé une CB pour diffuser les Évangiles aux païens. La mère a choisi un nom de code à rallonge – «Lumière Bienveillante».
Le roman commence par : «Comme la plupart des gens, j’ai longtemps vécu avec ma mère et mon père. Mon père aimait regarder les combats de catch, ma mère, elle, aimait catcher.»
J’ai lutté à mains nues quasiment toute ma vie. Dans ce genre de combat, le vainqueur est celui qui frappe le plus fort. Ayant été battue dans mon enfance, j’ai appris très tôt à ne pas pleurer. Si je passais une nuit enfermée dehors, je m’asseyais sur le pas de la porte jusqu’à l’arrivée du laitier, je buvais les deux pintes qu’il nous livrait, abandonnais là les bouteilles vides pour faire enrager ma mère et partais à l’école.
Nous allions partout à pied. Nous n’avions pas assez d’argent pour acheter une voiture ou nous payer le bus. À moi seule, je parcourais en moyenne huit kilomètres par jour : trois pour aller à l’école et en revenir ; cinq autres pour l’église.